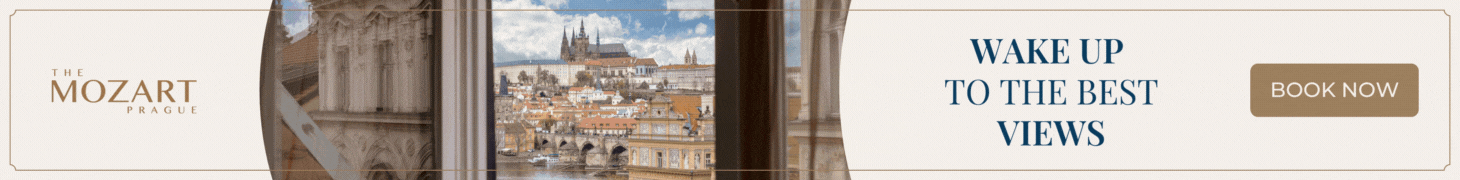Mais que se passe-t-il à l’Opéra Bastille ? Un soir de première, un nouveau spectacle, et aucun sifflet, même pas pour le metteur en scène ? À vrai dire, c’est même une salle debout qui a salué les artistes à la fin de cette nouvelle Turandot ! Nouvelle pour l’Opéra de Paris, car le spectacle a déjà été accueilli triomphalement à Madrid où il fut créé en 2018. Premier artisan de ce succès, Gustavo Dudamel, que le public parisien (et l’Orchestre de l’Opéra) ont de toute évidence déjà adopté. Une orchestration luxuriante, une écriture harmonique d’une originalité et d’un raffinement constants (ne faisait-elle pas l’admiration d’un Schönberg ?), de violents contrastes dramatiques : Turandot constitue évidemment une excellente carte de visite pour un chef, et permet de faire valoir aussi bien ses qualités que celles de l’orchestre. De fait, Dudamel est apparu à son aise dans toutes les dimensions de l’œuvre, dont il parvient à exprimer la noirceur et la violence sans pour autant céder à certaines facilités, à commencer par ces excès de décibels qui relèvent souvent plus du « tape-à-l’oreille » que de la véritable construction dramatique. Il est en cela secondé par un Orchestre de l’Opéra des grands jours, avec lequel une belle complicité semble s’être installée, et des chœurs plus précis et plus homogènes qu’à l’accoutumée, n’étaient quelques attaques parfois un peu flottantes.
Quant à la mise en scène de Bob Wilson, elle constitue sans aucun doute, avec Madame Butterfly et Pelléas et Mélisande, l’une des plus belles réussites du metteur en scène américain à l’opéra. Son langage scénique épuré, l’aspect glacial et hiératique des tableaux qu’il donne à voir non seulement permettent d’éviter toute redondance (mélo)dramatique avec la musique (redondance qui peut vite s’avérer fatale à l’émotion dans ce type de répertoire), mais constituent au contraire un écrin particulièrement apte à dégager toute la violence des situations et des émotions que l’œuvre recèle. Au sortir du spectacle, on garde longtemps en mémoire plusieurs tableaux saisissants : l’arrivée de Turandot drapée de rouge sur une passerelle semblant suspendue dans les airs ; celle, émouvante, du Prince de Perse, à moitié nu, flanqué de ses gardes ; le long trait de lumière dorée qui déchire le mur rouge lors du chœur final, symbolisant l’irruption de l’amour dans le cœur de l’héroïne ; et surtout la mort de Liù, d’une intense poésie. Au moment d’expirer, le corps de la petite esclave se fige dans une lumière bleutée, avant que le personnage ne quitte lentement la scène, suivi par Timur, pendant que se fait entendre le douloureux chœur funèbre « Ombra dolente, non farci del male ! ».
Qu’aurait-il donc fallu pour que la fête soit complète ? Tout simplement une distribution à la hauteur de l’événement. Aucun des artistes engagés par l’Opéra ne démérite, mais aucun ne marque les esprits. Ce sont les seconds rôles qui apportent les meilleures satisfactions, avec un Altoum (Carlo Bosi) bien chantant, ce qui est loin d’être toujours le cas dans ce rôle souvent sacrifié, et maîtrisant parfaitement son vertige, ce « Fils du ciel » passant tout le deuxième acte suspendu dans les airs à plusieurs mètres du sol ! Excellents, les trois ministres Ping, Pang et Pong (Alessio Arduini, Jinxu Xiahou et Matthew Newlin), parfaitement homogènes vocalement et s’étant approprié très efficacement le langage wilsonien, leur imposant de nombreuses pirouettes et mimiques. Timur est quant à lui servi par la voix sombre et le chant noble et poignant de Vitalij Kowaljow.
Guanqun Yu (Liù) dispose d’un beau timbre de soprano lyrique, soigne son chant, nuance, mais reste trop placide dans l’expression pour émouvoir. Lors des premières interventions de Gwyn Hugues Jones, on se dit que sa voix claire et légère, très éloignée du ténor spinto – voire dramatique – souvent distribué dans ce rôle, nous changera des Calaf « tout en muscles » et apportera au personnage une touche de fragilité bienvenue. Mais le chanteur est souvent poussé dans ses derniers retranchements, et est parfois submergé par l’orchestre, notamment dans sa révélation finale : « Io son Calaf, figlio du Timur ! ». Enfin, Elena Pankratova affronte crânement le personnage éponyme et surmonte l’essentiel de ses difficultés : si les aigus ne sont pas tout à fait aussi tranchants qu’on pouvait l’espérer d’une habituée des rôles d’Elektra, de la Teinturière ou d’Abigaille, ils sont habilement négociés et (presque) tous efficacement projetés ; la puissance, sans être exceptionnelle, est suffisante ; et l’interprète prend soin de ne pas proposer un personnage « monolithique ». Pourtant, il manque, pour que l’incarnation soit mémorable, une couleur de timbre plus personnelle, et surtout l’indispensable part de fragilité qu’un legato et des nuances piano (dans l’évocation de son ancêtre Lou-Ling, ou dans la douloureuse confession finale) apportent au personnage.
Quoi qu’il en soit, le public était à la fête ! Comme quoi, le succès d’une soirée d’opéra ne repose pas sur les seules épaules de ses interprètes vocaux…